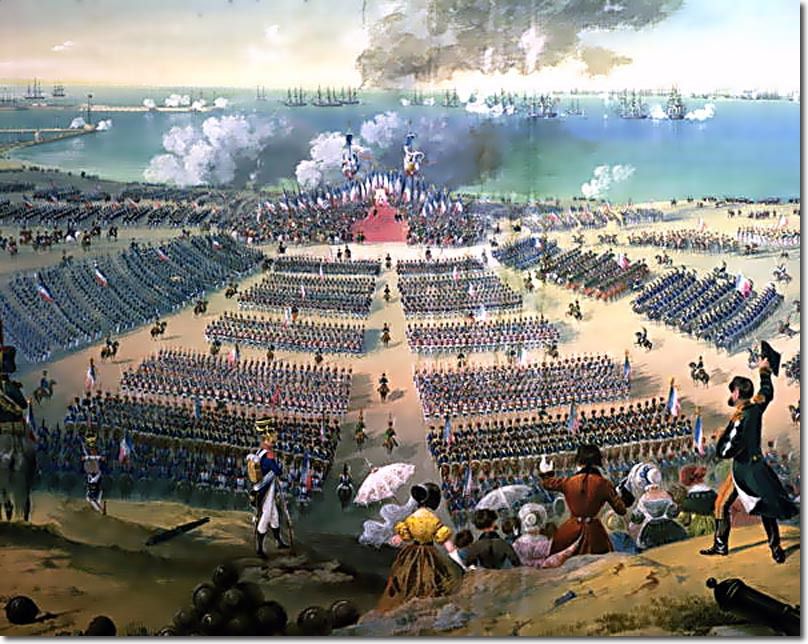A Zaza à qui j'ai souvent pensé en parcourant sur le web les routes de son pays natal et les malheurs qui y ont semé les soldats de Napoléon.
Napoléon choisit le très prestigieux Masséna pour diriger la dernière tentative d'invasion, destinée à porter un coup décisif au sanctuaire que constituait le Portugal pour l'armée britannique, venue en soutien des troupes portugaises et espagnoles.
Il ne mesura pas alors combien cette armée formidable dotée de 65 000 hommes allait être mise à mal une nouvelle fois, non seulement par un ennemi désormais très organisé mais également par les jalousies et ressentiments des généraux Junot, Montbrun et Reynier et du maréchal Ney à l'encontre du commandant suprême de cette nouvelle armée.
C'est aussi à cette époque que s'acheva le parcours du soldat Brianceau dans les terres ibériques.
La dernière tentative échoue également
Masséna prit son commandement à Salamanque en mai 1810. Son armée était constituée des 2ème, 6ème et 8ème corps d'armée.
Le premier écueil fut rencontré en Espagne. Ciudad Rodrigo constituant un point stratégique était naturellement défendue par une garnison importante. Il fallut 41 jours pour en venir à bout. La progression fut lente jusqu'à la position stratégique de la ville portugaise d'Almeida qui nécessita un nouveau siège du 15 au 28 aout 1810. Cette fois-ci, la chance sourit aux Français puisque des bombardements firent sauter un dépôt de poudre qui causa de nombreux morts civils et militaires à l'intérieur de la place. L'enceinte n'était pas endommagée mais la confusion due à cette explosion permit aux assiégeants de prendre l'avantage. La capitulation fut proposée puis d'abord refusée avant d'être acceptée. La prise d'Almeida constitua une aubaine car elle contenait des réserves très importantes de nourriture constituées dans la perspective du siège.
L'armée française pénétrait dans un territoire déserté par ses habitants marchant vers l'ouest sur la rive droite du Mondego, en direction de Coïmbra. En effet, l'armée anglo-portugaise avait verrouillé l'accès le plus facile vers Lisbonne en tenant des positions stratégiques le long de la rivière Alva.
Les différents corps d'armée français se retrouvèrent à Viseu le 21 septembre.
La première bataille importante eut lieu à Buçaco le 27 septembre 1810. Cette position stratégique sur la route de Coïmbra est formé d'un long plateau d'environ
N'étant pas à même de discerner l'importance des troupes ennemies et de la puissance de leur position, Masséna décida d'engager le combat en menant l'offensive principale par la route de Buçaco qui était gardée par trois détachements déployés depuis le milieu de la montagne jusqu'à son sommet, l'autre attaque étant conçue pour prendre d'assaut le plateau par l'autre route. Un premier assaut qui conduisit 5000 soldats au sommet de la crête fut repoussé par une armée puissante qui semblait indélogeable. Quatre autres assauts s'ensuivirent sans succès.
Dans la nuit du 28 septembre, l'armée française contourna le plateau par le nord, suivant une route non gardée par les forces alliées en direction de Coïmbra. Le 29 septembre, le plateau fut dépassé, la troupe devait progresser lentement, emmenant avec elle les nombreux blessés lors de la bataille. Pendant ce temps là, les forces anglo-portugaises opéraient un mouvement inverse de retrait par le sud du plateau, dans la perspective de se replier derrière les lignes de Torres Vedras qui avaient été fortifiées pour constituer un barrage protégeant Lisbonne. Fidèle à sa stratégie de la terre brûlée, il emmena dans sa retraite la population civile pour qu'elle trouve refuge derrière la ligne soit près de 300 000 personnes.
Les troupes françaises arrivèrent le 1er octobre dans Coïmbra, désertée par ses habitants[1] et les troupes alliées qui l'occupaient, Wellington leur ayant ordonné de se retirer vers le sud, en même temps que l'ensemble de son armée. La ville fut littéralement mise à sac par l'armée française sans que les débordements des soldats comme des officiers aient pu être maîtrisés. Les très nombreux malades et blessés furent installés dans le couvent de Santa Clara a Nova, converti pour l'occasion en hôpital militaire.
Le 4 octobre 1810, Masséna ordonna le départ de l'armée pour le sud afin rallier Lisbonne, laissant derrière lui les nombreux blessés de la bataille Buçaco et uniquement une petite garnison d'environ 200 soldats valides.
Cette dernière campagne n'atteignit jamais Lisbonne. La ville était défendue par la ligne naturelle de Torres Vedras, des montagnes qui s'étendent de la mer au Tage sur environ 60 kms. L'armée française s'y cassa les dents dans une configuration à peu près similaire à celle qui signa son échec au pied du plateau à Buçaco. En découvrant cet obstacle naturel qui avait été renforcé fortifié à de nombreux endroits, Masséna n'aurait pu s'empêcher de s'exclamer devant des généraux comme Junot ou Loison qui connaissaient parfaitement le terrain pour l'avoir parcouru en 1807 : "Et ces montagnes ? est ce aussi Wellington qui les a construit ?".
Après deux tentatives infructueuses de franchissement à Sobral, l'armée française se retira sur Santarem dans un pays déserté et sans ressources. La retraite devint inéluctable et en mars 1811, les troupes françaises quittèrent une dernière fois le Portugal.
[1] Il était fait obligation aux populations civiles de fuir les territoires envahis selon la politique de la terre brûlée de l'armée anglo-portugaise.
Prisonnier des Anglais
Mais revenons à Louis Brianceau. Abandonné par l'armée le 4 octobre à Coïmbra avec ses camarades, pour l'écrasante majorité malades ou blessés.
Le 7 octobre 1810, le lieutenant colonel Nicholas Trant prit d'assaut la ville avec un détachement important d'environ 4000 soldats. A partir de là, les versions divergent.
La version héroïque relatée dans "Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français de 1792 à 1815" (tome 20), précise que la garnison française[1] défendit la place, avec l'ardeur du désespoir, sachant que de toute façon la défaite les conduirait avec leurs camarades blessés à une mort certaine. Retranchés dans le couvent, ils continuèrent à le combat avec ceux des blessés pouvant combattre à leurs côtés, jusqu'à l'acceptation de la capitulation proposée par Trant, étonné de tant de résistance.
Dans une lettre que Nicholas Trant adressa au Maréchal Beresford pour expliquer les évènements du 7 octobre, il précisa que son entrée dans la ville avec des troupes portugaises de Coïmbra donna lieu à des échanges de coups de feu, mais d'une faible résistance d'au plus une heure. La garnison française demanda la capitulation qui lui fut accordée avec la garantie de Trant qu'il les protégerait contre les troupes portugaises, hors d'elles à cause du pillage et des exactions commises par l'armée française. Finalement, seuls 7 à 8 soldats ne purent échapper à la vindicte des forces portugaises. Nicholas Trant évalua le nombre de prisonniers à environ 5000 dont à peu près 80 officiers mais il précisait le chiffre être approximatif[2].
Il déclara avoir assuré le lendemain l'escorte de l'essentiel des prisonniers à Porto, afin d'éviter qu'ils soient massacrés en route. Selon a "history of the Peninsular war" de Charles Oman ce convoi était composé de 3507 malades et blessés, 400 soldats valides et quelques centaines de personnes relevant de l'intendance de l'armée. A leur arrivée à Porto, les soldats français quel que soit leur état, furent exhibés à l'occasion d'une parade qui s'étala sur trois jours ce qui fut reproché à Trant par certains officiers français. Dans "Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français de 1792 à 1815", Nicholas Trant aurait répondu avec ironie et morgue à un officier français qui s'insurgeait de cette parade, que "tous les moyens étaient bons pour exciter et entretenir l'enthousiasme du peuple".
En réalité, il semble bien que Nicholas Trant se soit employé à protéger les soldats prisonniers. On trouve un témoignage de reconnaissance d'officiers français adressé à Trant au moment où il quitta son poste de gouverneur de Porto. Également, la fille de Trant, Clarissa, précise que lors d'un séjour à Paris avec son père en 1817, il aurait été reconnu par un ancien officier qui s'était trouvé prisonnier à Coimbra et remercié pour sa conduite exemplaire.
Louis Brianceau a dû faire partie des malades ou des blessés, avant d'être convoyé à Porto, ville importante reliée à la mer dans laquelle il était probablement apparu plus simple de loger un nombre aussi impressionnant de prisonniers.
Ils furent cantonnés un temps dans la ville avant que leur évacuation vers l'Angleterre ait été organisée. En effet, au 19ème siècle, l'approche quant au sort fait aux prisonniers de guerre change progressivement et l'emprisonnement se généralise. Les Britanniques privilégièrent l'incarcération au Royaume-Uni pour des raisons tenant à la difficulté de les garder sur place au Portugal, compte-tenu des coûts d'entretien dans un pays dévasté. C'est pour ces mêmes raisons que les accords d'échange avec l'armée ennemie furent d'abord préférés afin de limiter le nombre de personnes à convoyer[3].
Le 26 octobre 1810, Wellington écrivit à l'amiral Berkeley qu'il devait mettre à disposition des navires afin d'évacuer 3800 prisonniers français[4], suite à la demande du lieutenant colonel Trant. Il s'agit très certainement du contingent de prisonniers dont il est question ici.
Je n'ai pas trouvé exactement quand ce transport put être opéré. Il est possible que finalement ces personnes aient transité d'abord par Lisbonne avant de repartir vers le Royaume-Uni. Là-bas, il aurait été emprisonné soit sur un bateau-prison soit dans une prison du sud de l'Angleterre telle que Porchester Castle qui accueillit en 1810 des prisonniers en provenance du Portugal ou d'Espagne, ou encore la prison de Dartmoor.
Le 22 mai 1814, après presque 4 ans de captivité, le soldat Louis Brianceau revenait en France.
[1] Selon le lieutenant colonel Trant, cette garnison ne comptait que 200 soldats tandis que dans l'ouvrage précité, elle en aurait compté 500.
[2] ses hommes comptèrent la prise de 3500 fusils
[3] Paul Chamberlain "The release of prisoners of war from
[4] Dans "The dispatches of Field
Et après ?
Est-ce qu'après cette vie de combats, le soldat Brianceau "est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge" raccrochant son fusil et sa baillonnette ?
Son dossier militaire prouve le contraire. Le 16 septembre 1814, il fut incorporé au 69ème régiment d'infanterie et passa du service de l'Empire à celui de la Restauration.
Puis à nouveau aux ordres de l'Empereur échappé de l'Ile d'Elbe. Le 20 mars 1815, Napoléon revint au pouvoir et le soldat Brianceau fut nommé caporal le 6 mai. Napoléon avait certainement besoin de ces soldats chevronnés qui avaient défendu sans faillir la République, le Consulat puis l'Empire, dans la perspective des batailles à venir et notamment de la dernière d'entre elles à Waterloo. Louis Brianceau survécut à ces dernières épreuves et ne rentra en Vendée que le 21 septembre 1815, "par suite de son licenciement".
Sa constance dans "la carrière" comme le dit si bien l'hymne national s'explique selon moi.
La vie qu'il avait choisi puis dans laquelle il fut ensuite entraîné, cette vie dure, il n'en connaissait pas d'autres ; aucune d'aussi bonne et aventureuse aurait-il peut-être pu songer.
Il avait combattu en Vendée, en Bretagne, puis sous le soleil de l'Italie comme dans les rigueurs du nord et de l'Allemagne. Il avait ensuite connu la faim dans la péninsule ibérique, la peur des guérillas - si particulières pour les habitués des champs de bataille classiques - et de la violence qu'elles suscitent, avec des exactions de toute sorte et des pillages auxquels il participa très certainement.
Mais ce long parcours de vie passé à pied sur les routes et les champs de bataille d'Europe, il le fit avec d'autres soldats avec lesquels il partagea tout; la joie, l'altruisme, la sauvagerie, les angoisses ou la peur et l'esprit de sacrifice.
Dans l'ouvrage "Guerre, être soldat en Afghanistan" pour la rédaction duquel son auteur, Sebastian Junger, s'est immergé dans le conflit afghan, celui-ci décrit parfaitement ce que vivent les hommes dans la guerre. Cette expérience humaine qui transcende les époques et les cultures.
Plus que l’amitié ou la fraternité, c’est l’amour qui lie les hommes du peloton. Ce mot s’impose. Chacun est prêt à risquer sa vie pour n’importe quel autre. Quelle meilleure définition de l’amour ? Donner sa vie pour que l’autre puisse garder la sienne. « Je me jetterais sans hésiter sur une grenade pour eux, m’a dit un gars. N’importe lequel d’entre eux le ferait pour moi. » Et c’était vrai. Ce n’est pas une règle implicite de l’armée. On ne donne pas sa vie pour suivre une règle. Et ce n’est pas l’armée qui peut créer l’amour. Ce sont les circonstances. Le brouillard du combat obscurcit votre destin - on ne sait pas où et quand on va mourir - et de cette interrogation naît un lien désespéré entre les hommes. Ce lien constitue le cœur même de l’expérience du combat et la seule chose sur lequel on peut absolument compter. L’armée peut vous rouler, votre girl-friend vous plaquer et l’ennemi vous tuer, mais l’engagement qui veut que chacun protège la vie des autres n’est pas négociable. Même les religions ne parviennent pas à inspirer un tel amour et cet esprit de sacrifice. C’est ce qui pousse à se surpasser, bien plus que l’instinct de conservation ou un quelconque idéalisme. Le courage est bel et bien de l’amour. Dans la guerre, l’un ne peut exister sans l’autre.[...]
De retour en Vendée, il recommença tout à zéro puisqu'il fut domestique dans une ferme à 40 ans révolus et non le métayer qu'il aurait pu être au même âge.
Il se maria en juillet 1816 avec Marie Merceron, se liant avec une famille que je suppose avoir eu les mêmes affinités politiques que lui-même, devenues à ce moment là très minoritaires.
Napoléon parti et la Restauration établie, les notables du village, - napoléoniens d'hier -, sentirent le besoin de changer leur fusil d'épaule. Ainsi, l'accueil au retour par les autorités et la population manqua très certainement de fanfare et de faste.
A ce décalage de point de vue, il faut ajouter celui qui devait apparaître entre ces soldats démobilisés et leurs familles.
A priori, il n'y eut rien à voir ni à partager avec le frère ou la sœur qui avait travaillé à faire prospérer la métairie. D'ailleurs, ses fréquentations familiales semblent avoir été limitées à son beau-frère Jean Boissinot[1] et à la jeune sœur Marie Perrine. J'imagine qu'il eut bien des histoires à raconter à un auditoire limité et de plus en plus clairsemé.
Il mourut le 16 septembre 1823, seulement 8 ans après son retour, à 47 ans, peut-être dans les regrets de cette vie, pourtant faite de guerres.
[1] Il est le seul témoin familial à son mariage.
commenter cet article …